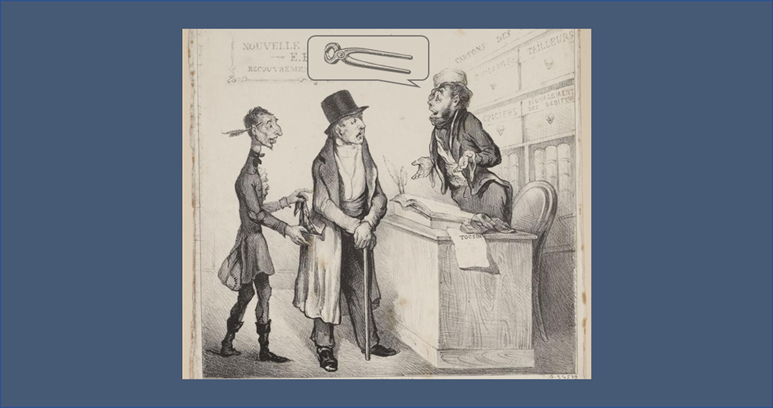Depuis que les dérives de l’indigénisme sont devenues flagrantes, une frange croissante de la gauche antiraciste s’attache au concept de « tenaille identitaire » développé par Gilles Clavreul en 2016 pour décrire la situation d’une pensée universaliste qui devrait lutter, sur son flanc gauche, contre un mouvement indigéniste faisant de la race l’alpha et l’oméga de la sociologie et, sur son flanc droit, contre un mouvement identitaire européen obsédé lui aussi par la race, et faisant de la démographie la clef de compréhension du monde contemporain.
Cette vision est juste, en ce sens qu’il existe en effet deux mouvements intellectuels de contestation de l’antiracisme tel qu’il s’est développé dans les pays occidentaux dans la seconde moitié du XXe siècle. Pourtant, la « tenaille » est avant tout une image et la force des images est de faire toujours passer plusieurs idées simultanément.
En l’occurrence, cette expression ne décrit pas seulement un état de fait sur lequel à peu près tout le monde s’accorde : il en impose une interprétation précise, qui se fait passer pour un constat et empêche toute critique en se présentant comme allant de soi. Or ce qui, dans l’image de la tenaille, relève de l’interprétation des faits, n’a rien d’évident, comme nous allons le voir.
***
Trois idées en contrebande
Une tenaille est un objet composé de deux pièces de métal symétriques employées conjointement pour serrer ou trancher un objet. Admettre l’emploi de ce terme pour désigner la montée de l’indigénisme et de l’identitarisme implique l’acceptation implicite de trois idées :
1) Ces deux mouvements sont équivalents dans leur nature (une obsession de la race) et opposés pour des raisons contingentes, notamment leur composition ethnique.[1]
2) Chacun des deux mouvements a besoin de l’autre pour exister et se renforce de ses critiques, qui lui permettent de radicaliser ses partisans et d’attirer dans ses filets de nouveaux adeptes.[2]
3) L’antiracisme universaliste est menacé par les deux mors de cette tenaille, alors que, sans eux, il se porterait très bien et permettrait aux sociétés occidentales de vivre en paix. Ce positionnement est particulièrement périlleux et héroïque, puisqu’on y subit les tirs croisés des deux courants de pensée « identitaires », pour défendre une position morale équilibrée : l’universalisme.
Ces trois idées ne sont pas discutées, elles ne sont pas démontrées, elles sont simplement contenues dans l’image de la tenaille. C’est le problème que nous voulons ici mettre en lumière : l’image est en effet très bien choisie pour suggérer une interprétation particulière d’une situation que tout le monde peut constater. Cette interprétation est bonne ou mauvaise, elle mérite en tout cas d’être discutée et non passée frauduleusement à travers une métaphore. Pour montrer qu’il ne s’agit pas d’une description factuelle du phénomène mais bien d’une interprétation, il suffit d’énoncer une autre interprétation des mêmes faits pour laquelle l’image de la tenaille perdrait toute sa pertinence. C’est ce que nous nous proposons de faire à présent.
Qu’est-ce que l’antiracisme ?
L’antiracisme n’est pas un principe universel permettant de juger du bon gouvernement des sociétés ni une morale individuelle évidente consistant à rejeter la haine raciale. Il s’agit d’une doctrine qui est une exception historique et géographique probablement née (pour simplifier) du rousseauisme et du traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale et propre à l’Occident contemporain. La plupart des autres pays du monde, ainsi que l’Occident jusque récemment, placent et plaçaient au sommet de leur hiérarchie des priorités la paix civile, condition nécessaire de leur indépendance et de leur sécurité. Même la première législation antiraciste française, les décrets-lois Marchandeau du 21 avril 1939, avait pour objectif la protection de la cohésion nationale, menacée par la propagande étrangère anti-juive de l’ennemi nazi[3]. La doctrine antiraciste, elle, propose d’autres objectifs politiques reposants sur des postulats anthropologiques spécifiques justifiant une philosophie politique particulière :
- Postulats anthropologiques :
- Il est naturellement très facile de faire cohabiter des populations différentes mais le racisme, une idéologie malveillante, menace le « vivre ensemble »,
- Toutes les populations ont la même capacité à cohabiter les unes avec les autres et à réussir socialement et les différences observables dans ces domaines ne peuvent donc s’expliquer que par des discriminations injustifiées.
- Philosophie politique :
- Le pire des maux n’est donc pas la guerre civile (dont la crainte n’est qu’un fantasme alimenté par des idéologies haineuses) mais la persécution des minorités,
- Le rôle des gouvernements n’est pas de défendre les intérêts de leurs peuples mais d’œuvrer au bien des individus du monde entier.
- Objectifs politiques
- Les peuples occidentaux doivent ouvrir leurs frontières aux populations du monde entier car ils ne méritent par leur aisance matérielle et les autres ont, par conséquent le même droit qu’eux d’en bénéficier,
- Il faut former les peuples autochtones d’Occident à accepter l’« autre » par l’éducation et la répression.
Cette doctrine s’est fait accepter par les populations autochtones et immigrées en leur promettant un certain nombre de bienfaits. Aux autochtones, elle a fait trois promesses :
- La paix sociale car la fin de toute forme de discrimination devait faire disparaître la violence,
- La prospérité car les populations étaient censées être toutes identiquement productives et les nouveaux arrivants apporter leur jeunesse et leur énergie,
- Le rayonnement international car, en devenant un modèle de cohabitation des communautés, la France était certaine d’être admirée et imitée des pays du monde entier.
La doctrine de l’antiracisme politique n’était pas avare de faux serments et, aux populations immigrées également, elle a fait trois promesses :
- Une intégration aisée à la société d’accueil ne nécessitant pas le déchirement identitaire de l’assimilation,
- Un bon accueil inconditionnel de la part des autochtones, sur qui reposerait la responsabilité du « vivre-ensemble »,
- Un niveau de vie comparable à celui de la population d’accueil, par la disparition du racisme et l’activation de « l’ascenseur social ».
Les créanciers de l’antiracisme
Avec en vue de tels bénéfices, les principes antiracistes ont été mis en application dans les pays occidentaux à travers une immigration massive et une chasse à toute marque d’hostilité envers les populations étrangères nouvellement installées. La suprématie idéologique de cette doctrine fut telle que, pendant de nombreuses années, insulter la France fut une formalité pour certains jeunes immigrés ou descendants d’immigrés, la réaction des autochtones, solidement contenue par la loi, se limitant à quelques protestations « nauséabondes » de la part d’hommes politiques classés à l’extrême droite. On ne se figurerait pas un rappeur d’origine française vivant en Algérie ou en Chine, chrétien et portant un prénom français, chanter « Je baise la Chine » ou « Je nique l’Algérie, cette salope », puis se plaindre de n’être pas apprécié des Chinois ou des Algériens. C’est tout simplement inimaginable, de même qu’il fut alors inimaginable, en France, de pénaliser les injures envers la France, voire simplement de s’en indigner ou de s’en inquiéter.
L’antiracisme a donc bel et bien été appliqué sans entrave or que constate-t-on aujourd’hui ? Après un demi-siècle d’application stricte, la politique antiraciste n’a pas fonctionné. Les promesses faites aux populations immigrées n’ont pas été tenues : malgré une lutte acharnée contre le racisme ayant fait presque totalement disparaître les marques d’hostilité à leur égard et les discriminations raciales, elles n’ont apparemment pas atteint, en moyenne, le niveau de vie de la population autochtone. (Bien qu’elles aient atteint un niveau de vie qui eût été hors de leur portée dans leurs pays d’origine.) Sans le douloureux effort d’assimilation, elles n’ont pas été considérées par les Français comme des compatriotes. Les promesses faites aux autochtones n’ont pas non plus été tenues : une partie importante des populations nouvellement installées en France a développé une haine croissante à leur égard, qui menace de plus en plus sérieusement la paix civile ; elles ne semblent pas contribuer globalement à l’enrichissement du pays, bien au contraire ; et la générosité de la France ne lui a valu ni l’admiration du reste de l’Occident ni la reconnaissance des pays d’origine des immigrés. La doctrine antiraciste n’est donc pas menacée aujourd’hui par une alliance improbable et soudaine entre deux mouvements identitaires. Elle n’est pas, à proprement parler, menacée, si ce n’est par la réalité : la doctrine antiraciste a tout simplement échoué.
Si cette seconde interprétation de l’affrontement entre indigénistes, antiracistes universalistes et identitaires est la bonne, le problème que rencontre aujourd’hui l’antiracisme n’a rien à voir avec celui d’un fil de fer enserré dans une tenaille : le fil de fer se porterait très bien sans la tenaille tandis que l’antiracisme ne se portrait pas mieux si ses deux critiques s’arrêtaient. Ces deux mouvements ne se coalisent pas pour venir à bout d’un idéal viable ; ils viennent seulement demander des comptes à une idéologie politique mensongère, présenter la facture des promesses non tenues : ils sont les créanciers de l’antiracisme.
***
Nous voyons donc que l’image de la tenaille identitaire, loin de se limiter à un constat évident, en impose une interprétation tout à fait contestable qui a, pour ses tenants, l’intérêt certain de les dédouaner de toute responsabilité dans l’échec de leur doctrine et dans le désastre de politiques migratoires dont nous commençons à peine à apercevoir les conséquences terribles. Nous nous proposerons donc, dans les prochains articles de ce dossier, de critiquer une à une les trois thèses contenues dans l’image de la tenaille, afin de justifier la pertinence de son alternative, celle des « créanciers de l’antiracisme ».
[1] « Pourquoi ‘tenaille’? Parce que ces propositions que tout oppose politiquement, par exemple celle des suprémacistes américains et celles des ‘wokes’, s’articulent néanmoins autour d’un même axe, en l’occurrence celui de la race. Elles prétendent rapporter ce que l’on dit et ce que l’on pense à ce que l’on est. » (Gilles Clarveul, « ‘Tenaille identitaire’: la réponse de Gilles Clavreul à Alain Finkielkraut », Le Figaro, 29 avril 2021)
[2] « Second attribut de la tenaille : la pression de la pince gauche accentue celle de la pince droite, et réciproquement. Elles s’entre-alimentent dans une surenchère d’anathèmes et de procès en sorcellerie où chacun est sommé de prendre parti ou enrôlé de force dans l’un ou l’autre camp. » (Gilles Clarveul, Ibid.)
[3] Voir à ce sujet Emmanuel Debono, Le Racisme dans le prétoire, PUF, 2019
Illustration : Lithographie, Sastre Brunet, Horace Antoine (H. Brunet et Cie), dessinateur-lithographe, Musée Carnavalet, Histoire de Paris (détail et image bien entendu légèrement modifiée)